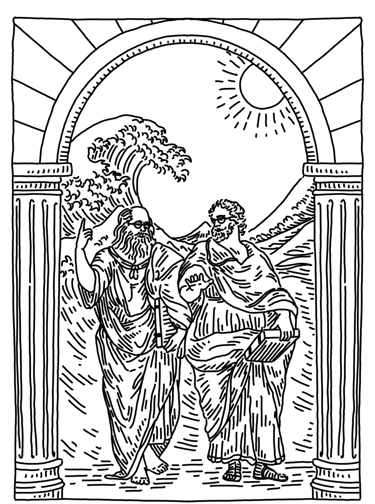Carnet de lecture : l'Afrique du Sud
Bilan du voyage livresque en Afrique du Sud
11/11/202511 min temps de lecture


Le veld, un personnage à part entière de la littérature de l'Afrique du Sud
Le grand labyrinthe de l’Afrique du Sud
Après la lecture de l’Histoire de l’Afrique du Sud de Gilles Teulié, on croît avoir les grandes lignes nécessaires à la compréhension du pays : la période précoloniale, l’arrivée des hollandais, l’établissement des premières colonies anglaises, les grands treks, la guerre menée par Chaka, l’esclavage, l’exploitation des populations noires dans les fermes, la guerre anglo-boer, la découverte des mines d’or, l’apartheid et Nelson Mandela.
Et si ces références sont nécessaires à la compréhension du contexte, on se rend rapidement compte que cette histoire repose sur un océan de complexité indémêlable.
Par hasard (je ne lis pas les synopsis), la première œuvre que j’ai approché est En étrange pays de Karel Schoeman, qui raconte la vie d’un hollandais en voyage en Afrique du Sud au XIXème siècle pour se soigner d’une maladie indéterminée, pratique qui semblait courante. On y découvre la vie d’une petite ville, sa nature, ses fractures sociales et surtout la solitude, thème principal du roman. Cette solitude vient d’abord de la ville, éloignée de tout, mais également de la nature, le veld (la prairie) s’étendant à perte de vue, ne laissant aucun doute sur la réalité de l’isolement. Elle vient ensuite des relations sociales dans lesquelles le personnage ne se retrouve pas : la violence banalisée sur les noirs et l’inculture des blancs, vus comme des frustres (historiquement, les sud-africains blancs non anglophones étaient parfois appelés «les sauvages blancs» par les européens). Pensant retrouver des congénères, il ne trouve finalement que des étrangers, avec lesquels il ne peut tisser de liens. Un salut est possible, liant les hommes et la nature, dont je laisse la découverte à ceux qui feront le choix d’aller lire En étrange pays. En tous les cas, un livre hautement recommandable, qui rend tangible les sentiments qu’il se propose d’illustrer.
Je me suis ensuite dirigé vers Triomf de Marlen van Niekerk, du nom d’un quartier de Johannesburg construit sur un ancien quartier noir, à destination des « petits blancs », c’est-à-dire les blancs pauvres et sans éducation, pendant l’apartheid. Bon à savoir avant la lecture : la défense des petits blancs était une des justifications de l’apartheid, notamment du point de vue professionnel, en les protégeant de la concurrence avec la main d’œuvre noire. Triomf raconte la vie d’une famille de petits blancs dans Triomf, à la fin de l’apartheid. La narration est excellente. Les faits sont tristes, la famille est extrêmement pauvre, sur une toile de fond de viols, alcoolisme, rejets des autres et surtout sans aucune perspective d’amélioration pour personne, mais l’auteur raconte chaque histoire avec douceur, les personnages agissent avec un détachement quasi absolu de leurs conditions de vie et se mettent en scène eux-mêmes, ce qui amène à un savant mélange de comique et de saveurs douces-amères à la lecture, soulignant parfaitement les moments les plus tragiques. Il faut également retenir une narration qui laisse de l’espace au lecteur, en le laissant déduire plutôt qu’en lui disant. D’un point de vue plus sociologique, Triomf donne un portrait des petits blancs attendant la fin de l’apartheid avec une certaine anxiété (la crainte de la guerre civile), mais sans conscience politique particulière (sans être contre l’apartheid, Mandela est vu comme une personne bien), le sujet étant trop loin de leurs préoccupations quotidiennes.
Nadine Gordimer (Ceux de July, Le conservateur, La voix douce du serpent)a été mon escale suivante. Je n’en dirai pas grand chose, parce que je me suis retrouvé face à ses livres comme devant des statues : la technique m’impressionne, le talent est là, mais cela n’éveille pas de sentiment artistique particulier chez moi. Un des grands thèmes de Nadine Gordimer est la relation entre les blancs aisés et les noirs. Des trois que j’ai lus, Ceux de July est le plus intéressant. A grands traits, il s’agit d’une petite famille de blancs suffisamment aisée pour se payer les services d’un domestique noir, July. Lorsque les émeutes de protestation contre l’apartheid commencent, la famille a peur d’en être victime, et July leur propose de venir vivre dans son village le temps que cela se calme. Alors que la famille pensait être exemplaire avec July, elle découvre petit à petit les non-dits de la relation, inégale à un point que la famille n’imaginait pas avant. Le sujet est traité avec nuances, délicatement, et même si l’écriture n’a pas fonctionné sur moi, littérairement parlant, j’en recommande la lecture.
André Binks, un des sestigers, dans Une saison blanche et sèche, propose la vision d’un blanc aisé, craquant face à l’apartheid. En voulant rendre service à une de ses connaissances noires, Gordon, dont l’enfant a disparu au cours d’une manifestation, probablement enlevé par la police secrète, Ben met le doigt dans un engrenage. Puis Gordon disparaît aussi. Ben cherche à faire le jour sur ce qui leur est vraiment arrivé. Ici, l’auteur dépeint un système totalitaire qui détruit toute personne s’élevant contre lui, sans distinction, et le découragement, l’isolement, la violence qui attend toute personne cherchant à s’y opposer. L’écriture et la narration sont excellentes, en nous immergeant parfaitement dans l’état d’esprit du personnage, sombrant petit à petit dans la paranoïa, qu’on finit par partager. Hautement recommandable.
De l’autre côté de la barrière de l’apartheid, Pleure Ô mon pays bien aimé, de Alan Paton, est un roman exceptionnel. Je n’ai absolument aucune preuve de ce que j’avance, mais j’ai la sensation que l’auteur a écrit son œuvre avec le mythe d’Orphée ou la Divine comédie en tête. Un pasteur noir reçoit un jour, dans son petit village traditionnel qu’il n’a pratiquement jamais quitté, une lettre d’un autre pasteur de Johannesburg qui lui apprend que sa sœur est touchée par une maladie terrible (une mauvaise vie), et qu’il faut qu’il vienne sans tarder. Il prend donc le premier train pour Johannesburg pour retrouver sa sœur, mais aussi son fils et son frère dont il n’a plus de nouvelles depuis des années. Son objectif est au moins de ramener son fils et sa sœur au village et de les réintégrer dans la tribu. Le héros descend en enfer pour aller chercher ses proches, et trouvera un guide connaissant les rouages de la ville pour l’aider à ne pas perdre son chemin. En plus d’aborder de front de nombreuses questions, comme la perte du mode de vie tribal et des valeurs associées, la justice, la vie heureuse, les modes de lutte contre un système injuste, le roman fonctionne a plusieurs niveaux de lecture. Peut-être le meilleur roman que j’ai lu pour l’Afrique du Sud.
Ensuite, deux œuvres qui se situent pour la première avant l’apartheid (et même avant l’indépendance de l’Afrique du Sud) et la seconde après l’apartheid. Histoire d’une ferme africaine d’Olive Schreiner m’a laissé peu de souvenirs, à part quelques passages intéressants sur la place des rêves dans une vie, j’ai trouvé ce roman relativement plat.
En revanche, Au pays de l’ocre rouge de Zakes Mda (publié en 2000) m’a beaucoup plus. Cette histoire se fonde sur celle de Nongqawuse, l’histoire vraie d’une prophétesse Xhosa qui, en 1856, a eu des visions selon lesquelles l’abattage de tout le bétail Xhosa permettrait le retour des ancêtres qui viendraient alors prêter main-forte pour lutter contre les colons. Une partie du peuple Xhosa l’a écouté, et presque toutes les bêtes furent abattues, causant une famine extrême (au moins 40 000 morts) et des affrontements entre les partisans de Nongqawuse et les opposants à l’abattage du bétail. J’avais lu dans l’Histoire de l’Afrique du Sud qu’un ressentiment entre les deux camps avait subsisté après cet épisode, les partisans de la prophétesse accusant les opposants de ne pas avoir abattu leurs bêtes, et donc d’avoir empêché la prophétie de se réaliser. Les opposants accusaient les partisans d’avoir causé une famine terrible et d’avoir affaibli le peuple, et je m’étais demandé ce que la mémoire collective faisait aujourd’hui de cet événement. Au pays de l’ocre rouge raconte à la fois cette histoire et celle des descendants de ceux qui ont vécu la période de Nongqawuse, et à Qolorha-sur-Mer (village fictif mais situé sur les terres où Nongqawuse a vécu), les Croyants et Non-Croyants s’affrontent toujours, et ne sont d’accords sur rien. L’enjeu du récit contemporain est l’installation d’un casino et d’une station balnéaire pour riches, le rêve des Non-Croyants, détruisant ainsi une partie de la forêt sacrée (le cauchemar des Croyants). Zakes Mda est un excellent conteur, rend ses personnages attachants, et surtout traite finement des questions de l’héritage culturel et de l’acceptation (ou non) du progrès. Les positions des personnages sont tranchées jusqu’à l’absurde, ce qui, paradoxalement, permet de présenter un tableau très nuancé sur le débat. C’était une excellente lecture.
Pour terminer la partie purement littéraire, traitons simultanément Mhudi, Chaka et les Contes populaires des Bassoutos. Pourquoi simultanément ? Parce qu’ils illustrent parfaitement à quel point les cultures traditionnelles noires d’Afrique du Sud sont différentes des cultures blanches de la même aire géographique. La différence n’est pas qu’une simple question de référence, il ne suffit pas de savoir que Chaka a été un grand roi zoulou dont les conquêtes sans limite ont donné naissance au Mfecane (le cycle de guerres et de migrations forcées suite aux conquêtes zoulous de 1810 à 1840, occasionnant de 1 à 2 millions de morts) au XIXème siècle pour comprendre le Chaka de Thomas Mofolo. Son œuvre s’inscrit dans un fond culturel radicalement différent de ce que je connais, et il en va de même pour Mhudi (qui est d’ailleurs parfaitement complémentaire à la lecture de Chaka, puisque cette fois-ci les personnages sont les adversaires des zoulous) ou les Contes populaires des Bassoutos. Emettre un avis sur la qualité de ces livres seraient un non-sens, je ne suis pas en mesure de les juger, je me contenterai de dire que j’ai trouvé les lectures de Mhudi et de Chaka plaisantes. Je recommande chaudement leur lecture, tout simplement parce que c’est éminemment différent des lectures habituelles qu’on peut avoir en Europe. Le cas de L’homme qui marchait vers le soleil levant, également de Mofolo, raconte une conversion vers une des religions monothéistes, ce pont diminue la force de l’altérité.
Le grand Mandela
Avant de traiter de Mandela, il y a quelques livres non littéraires dont il faut parler.
Ndébélés et Parlons xhosa permettent de découvrir plus en détail les cultures de ces deux peuples. Ndébélés est un livre de photographies, on comprend immédiatement pourquoi les peintures Ndébélés ont conquis le monde entier, elles sont tout à fait magnifiques, et gagneraient à être encore plus connues. Parlons xhosa est avant tout un ouvrage de linguistique, mais proposant au début des explications circonstanciées sur la culture xhosa, je ne le recommande qu’aux plus passionnés.
Pour faire le lien avec Nelson Mandela, parlons de Mon cœur de traître de Rian Malan, qui est le meilleur livre que j’ai lu du voyage livresque en Afrique du Sud. Il s’agit principalement d’une compilation d’histoires autobiographiques et journalistiques s’étalant sur la période 1965-1990. On y suit le parcours de Rian Malan, de la communauté afrikaners, de son enfance jusqu’à la rédaction de ce livre, et surtout l’évolution de sa compréhension de l’Afrique du Sud. Engagé à gauche et anti-apartheid depuis ses plus jeunes années, il raconte que s’il a compris rapidement la nature fondamentalement néfaste de l’apartheid, sa première prise de conscience est que cette dernière n’est qu’une évolution « naturelle » de la domination des blancs sur les noirs en Afrique du Sud. C’est une position consensuelle, les historiens reconnaissant que l’apartheid n’est qu’une version ouverte et encore plus stricte des discriminations que subissent les noirs en Afrique du Sud depuis plusieurs siècles. Là où le récit devient vraiment intéressant, c’est lorsque l’auteur propose de mesurer le fossé qui sépare les blancs des noirs, puisque même une fois l’apartheid abrogée (le livre a été rédigé avant ce moment), il restera encore à créer des ponts entre les communautés. On ne peut que louer l’honnêteté intellectuelle de l’auteur qui rapporte sans pudeur les éléments qui viennent infirmer ses préjugés ou ses théories. Anti-apartheid jusqu’au bout, anti discrimination jusqu’à la dernière ligne, il relate pourtant les cas où il ne comprend pas les communautés noires, ses peurs et ses moments de désespoirs. Sa conclusion est que les communautés d’Afrique du Sud, qui ne se limitent pas à une opposition noires/blanches, ne se sont jamais parlées, mais qu’il existe un espoir, mince, mais un espoir quand même. S’il ne fallait lire qu’un livre, autre que Histoire de l’Afrique du Sud, je recommanderai celui-là, parce qu’il illustre parfaitement les tensions qui sous-tendent le pays depuis si longtemps.
Et c’est ce qui permet de prendre pleinement conscience de la grandeur du travail de Nelson Mandela. Au vu des discriminations qu’on subit les gens de couleurs (les noirs n’étaient pas les seuls concernés par l’apartheid) les siècles précédent, au vu des sévices subis par Mandela au cours de sa vie, au vu de son positionnement idéologique (il estimait que le recours à la violence est un moyen légitime), au vu de son entourage, personne n’aurait été surpris qu’une envie de vengeance l’habite. Faire ce choix de la réconciliation, et de faire son possible pour permettre aux communautés africaines de vivre en paix toutes ensembles (rappelons les violents affrontements entre les zoulous et les xhosa au lendemain de l’abrogation de l’apartheid) était sans doute la seule solution pour donner l’espoir d’une vie pacifique au pays, démontre une force de caractère hors du commun. Il a énormément œuvré pour permettre de créer un dialogue entre les communautés, et arrêter le cycle de la violence. Maintenant que je prends la mesure de son travail, je me dis qu’il n’y a pas assez de rues, de places ou de parcs à son nom.
Pour terminer ce voyage, une petite curiosité
Parmi tout ce que j’ai lu sur l’Afrique du Sud, un livre est un peu à part : The Soul Of The White Ant d'Eugène Marais. Je l’ai lu parce que son auteur est considéré comme marquant dans l’histoire littéraire de l’Afrique du Sud, et comme s’est un descendant des protestants français exilés après l’édit de Nantes, c’est un profil qui n’est pas représenté ailleurs dans la liste.
Je ne sais pas ce que c’est. The Soul Of The White Ant est à la fois une étude entomologique sur les termites d’Afrique du Sud s’appuyant, au moins en partie, sur la méthode scientifique du XIXème siècle (revue doxographique, formulation d’hypothèses puis test de ces dernières, etc.), mais aussi un ouvrage de philosophie. L’auteur plaide pour une révision de la qualification d’être vivant, en avançant que dans le cas d’une colonnie de termite, il n’y en a qu’un seul : la termitière. Prendre chaque termite isolément est une erreur, cela serait comme assimiler le cœur ou les globules rouges à des êtres vivants. Et bien entendu, il y a une réflexion plus métaphysique, sur la nature de l’âme, et notamment son emplacement dans le cas de la termitière.
Cap sur l’Albanie
Je pars pour l’Albanie sans avoir lu tous les livres prévus... il y en a plusieurs que je n’ai pas pu me procurer, mais c’est mieux ainsi, parce que je crois avoir eu les yeux plus gros que le ventre. La liste initiale était d’environ 28 livres, j’en ai lu seulement une vingtaine, et j’ai déjà envie d’aller vers d’autres contrées. La littérature d’Afrique du Sud est un labyrinthe sans fin, et je pense que j’y reviendrai un jour.
Maintenant, direction l’Albanie !