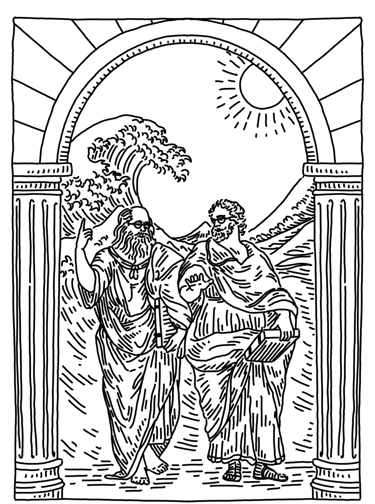Carnet de lecture : l'Afghanistan
Bilan du voyage livresque en Afghanistan
7/14/2025


En illustration sur la page d'accueil : la Mosquée Bleue de Mazâr-e Charîf
Ci-dessus : le lac de Band-e Amir
47 ans de guerres...
Qu'il s'agisse des livres d'histoire ou de littérature, les guerres sont des sujets incontournables. Depuis le coup d'Etat communiste d'avril 1978, l'Afghanistan connaît une série de conflits armés quasiment ininterrompue, dont voici en bref la chronologie :
1978, révolution de Saur (deuxième mois du calendrier persan, en dari), coup d'Etat des deux partis communistes, qui se livrent ensuite à des répressions sur le peuple. Rappelons que le communisme se caractérise notamment par son athéisme, ce qui a son importance auprès d'une population fortement religieuse.
1979, l'URSS envahit l'Afghanistan grâce à la collaboration du parti communiste au pouvoir. La résistance des moudjahidin, organisée en sept mouvements sunnites (et à majorité pachtoune) et deux mouvements chiites (à majorité hazara), utilisant les montagnes de la frontière avec le Pakistan comme base arrière. Bien que ces neuf mouvements soient unis contre l'invasion soviétique, d'importantes différences idéologiques peuvent les séparer. Pour donner un ordre d'idée, le spectre idéologique s'étend du Jamiat-e Islami (Société islamique), se réclamant d'un islamisme modéré et dont les membres ont par la suite combattus les talibans, au Hezb-e-Islami (Parti islamique), proche de l'école de Deoband, dont sont issus les talibans.
En 1989, l'URSS abandonne le combat et se retire, mais la guerre civile se poursuit, opposant toujours les moudjahidin au gouvernement communiste.
En 1992, le gouvernement communiste s'effondre, les moudjahidin s'affrontent maintenant entre eux, par les armes, pour obtenir le pouvoir. Le mouvement des étudiants (taliban en pachto) prend les armes en 1994 et commence également la lutte.
1996, victoire des talibans. Bien que la guerre civile semble avoir diminué en intensité, les pressions sur le peuple s'accroissent. Des mouvements de révolte s'observent : les talibans ont essayé de détruire la Mosquée bleue de Mazâr-e Charîf, un monument extrêmement important dans la culture afghane (des centaines de millier de personnes s'y rendent pour fêter le nouvel an et honorer le tombeau d'un saint) en 1997. La population locale massacre 3 000 talibans en réponse. L'an suivant, les talibans reprendront la ville et massacreront la population.
2001, intervention de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, qui fait tomber le régime taliban. Néanmoins, les talibans ne s'avouent pas vaincu, et s'apprêtent à mener une guérilla contre la coalition internationale et la nouvelle république mise en place. Notons que la coalition internationale est rapidement perçue comme une armée d'occupation par les populations locales.
2021, départ des dernières troupes américaines, retour des talibans au pouvoir. Comme en 1996, la paix est relative (je n'ai trouvé qu'une poche de résistance, située dans le Pandjchir, le Front national de résistance), mais la population subit toujours d'importantes brimades.
Ainsi, la plupart des afghans vivent depuis leur naissance dans un climat de guerre. Bien entendu, Si l'Afghanistan m'était conté de Alain Coppolani et Les Pachtouns, un grand peuple sans pays d'Alain Lamballe détaillent parfaitement les effets de la guerre sur la politique, l'économie et la démographie afghane d'aujourd'hui, et je ne peux qu'en conseiller très chaudement la lecture.
Les pachtounes
Historiquement, l'Afghanistan et le Pakistan sont nés de la colonisation britanniques, et le découpage des frontières a été réalisé sans consultation des populations locales. Cela amène au tracé de la ligne Durand, séparant l'Afghanistan du Pakistan, encore sujet de débats virulents aujourd'hui. Cette frontière sépare donc l'aire où vivaient historiquement les pachtounes, dont la plus grande partie de la population vit maintenant au Pakistan, la seconde partie étant en Afghanistan. Néanmoins, les pachtounes sont une minorité du Pakistan et une majorité en Afghanistan, où ils détiennent le pouvoir politique.
L'objet du livre d'Alain Lamballe, Les Pachtouns, un grand peuple sans pays, et de donner toutes les clés de compréhension d'un débat plus que centenaire : la création d'un pachtounistan. Cinq cas sont étudiés, de l'absorption du Khyber Pakhtunkhwa, une province pakistanaise, par l'Afghanistan, à la création d'un Etat ex nihilo.
Pour avoir une idée de l'origine de ce débat, le mieux est de s'intéresser au mode de vie des pachtounes dans les montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan, et justement, on a sous la main Les gardiens des Monts pakistanais de André Singer et Toby Molenaar (pour les photographies), qui ont vécu dans un village pathan (nom pakistanais des pachtounes) dans les années 70. Bien que ces montagnes soient juridiquement sous le contrôle du Pakistan, ce dernier n'y exerce absolument aucune autorité. L'Hindou Kouch compte plus d'une dizaine de pics dépassant les 6 200 mètres d'altitude, et un nombre spectaculaire de pics dépassant les 4 500 mètres. Lieu de vie habituel des pachtounes, il est peine perdue pour un étranger d'essayer de les poursuivre là-bas.
Les pachtounes vivent dans de petits villages, qu'on ne peut qu'avoir envie de qualifier d'anarchistes, puisque les pachtounes ne se soumettent à aucune autorité politique. Il n'y a pas de chef de village, et chaque famille est indépendante : une famille devant dépendre d'une autre pour obtenir sa subsistance (donc qui ne pratique pas l'agriculture) est vue comme étant inférieure. Les litiges ne se règlent que de deux manières : par la réunion d'une jirga, un conseil des notables du village qui tranchent le débat, ou le fusil dont ne se séparent jamais les pachtounes.
L'honneur est la notion centrale de la société pachtoune. En cas d'atteinte à l'honneur, la vengeance dans le sang est presque l'unique moyen de réparer l'outrage. Si la communauté estime que le meurtre était justifié, l'affaire s'en arrête là. Sinon, un cycle de vendetta se met en place, les morts pourront se compter par dizaines.
Les pachtounes pratiquent l'islam sunnites, la vie est rythmée par la prière. Dire que les pachtounes de l'Hindou Kouch sont de fervents croyants est un euphémisme, puisque la plupart des garçons ne reçoivent qu'une éducation religieuse, et il est rare que les filles en reçoivent une tout court. Le Pakistan a essayé d'ouvrir des écoles plus générales dans ces montagnes, mais ces tentatives se sont soldées par des incendies et des morts.
Cette place prépondérante de l'honneur est cristallisée dans le mode de vie des femmes, avec une pratique extrêmement stricte de la purdah. Matériellement, les femmes vivent la plupart du temps dans des lieux spécialisés entourés de hauts murs pour éviter d'être vues par les hommes. Si une femme a besoin de sortir, pour aller travailler au champs, ou puiser de l'eau à la rivière, elle doit porter une burqa pour se soustraire à d'éventuels regards. Un homme se promenant dans une zone où il risque de croiser une femme sera bien avisé de se déplacer avec un enfant, qui peut partir en éclaireur pour s'assurer que si femme il y a sur le chemin, elle soit bien voilée.
Pourquoi tant de précautions ? Parce que voir une femme dévoilée, qui n'est pas de la famille, entache à la fois l'honneur de l'homme qui a vu et de la femme qui a été vue. André Singer, ethnologue, a recueilli plusieurs témoignages et histoires où la mise à mort des deux fautifs a été reconnue parfaitement légitime par les deux familles. Il arrive également que dans de pareils cas, le père exécute lui-même la peine de mort sur son enfant, pour prévenir ainsi l'apparition d'un cycle de vendetta.
A mon sens, ce livre d'André Singer et de Tobby Molenaar doit être lu, déjà pour les belles photographies qu'il contient, mais également pour donner corps et substance aux explications données par les livres d'Alain Lamballe et Alain Coppolani. L'avantage majeur de ce livre est que Tobby Molenaar est une femme, elle a donc eu accès à des informations habituellement refusées aux hommes.
Dans tous les cas, ces livres permettent ensemble de comprendre l'importance de l'Hindou Kouch dans la géopolitique pakistanaise et afghane. Le meilleur exemple de cette importance est que cette chaîne de montagne a également constituée la base arrière de la guérilla des talibans après leur chute de 2001, et qu'il a été impossible de les en déloger.
La littérature
Sans surprise, la guerre et les répressions marquent au fer rouge la littérature de ces dernières années. La critique de la guerre et des répressions a couté la vie a Sayd Bahodine Majrouh (1), les témoignages de ces brimades sont également au cœur des œuvres de Mohammad Hossein Mohammadi, de Spôjmaï Zariâb et d'Homeira Qaderi (2). Pour terminer sur une note plus légère, nous évoquerons les Légendes et coutumes afghanes (3).
1. Sayd Bahodine Majrouh, une incroyable découverte
Sayd Bahodine Majrouh, d'ethnie pachtoune, est né en 1928. De ma compréhension, il fait partie de la minorité afghane pratiquant le soufisme, la branche ésotérique de l'islam. Le soufisme tel qu'il le présente dans son ouvrage Rire avec Dieu, aphorismes et contes soufis est une relation qu'on peut qualifier d'amicale avec la religion, et qui donne une part belle à l'humour. Cet ouvrage est un recueil de pensées de soufistes célèbres, qu'on peut illustrer aisément avec quelques citations :
"Je préfère la compagnie de gredins pleins d'humour à celles de grincheux lecteurs des saintes Ecritures." Juneyd, La Vie des grands hommes de Dieu
Après avoir vu passer les esclaves de 'Amid, tous bien nourris, bien habillés, le Fou s'exclame en regardant le ciel "Toi, Tout-Puissant Seigneur de la terre et des cieux ! Regarde moi : regarde ta créature, regarde ton esclave - et cours apprendre chez 'Amid comment T'occuper de Tes esclaves !" Attâr, La Conférence des Oiseaux
"Je suis bien davantage effrayé des péchés à venir que de ceux d'hier : je sais ce que j'ai fait - mais pire encore peut arriver !" Sâqiq Balkhi, Nafahat-ul-Hikam
Cette lecture a le double avantage de permettre une découverte du soufisme et de jeter un éclairage sur la pensée religieuse de Majrouh : ce n'est pas un fondamentaliste, loin de là.
Le second ouvrage que j'ai lu de lui est Le suicide et le chant, un recueil de poésie populaire des femmes pachtounes. Le genre de poésie pratiquée est le landay, qui signifie littéralement "le bref", probablement en pachto. Majrouh le décrit ainsi : il s'agit de poèmes composés de deux vers libres en neuf syllabes, sans rimes obligatoires mais avec de solides scansions internes. Les landays composés par les femmes pachtounes sont différents de ceux des hommes, dans la mesure où elles ne reçoivent aucune éducation, ils contiennent donc peu de références. Les thèmes évoqués sont également différents, les réalités quotidiennes l'étant aussi. Dans la sélection de Majrouh, on retrouve beaucoup de landays sur le vrai amour, en opposition aux mariages forcés habituels, la détestation du mariage forcé, l'injonction à l'héroïsme pour les hommes, la vie de servitude, l'exil et la sexualité (un grand nombre porte justement sur la pratique de l'adultère).
Les poèmes recueillis par Majrouh proviennent majoritairement de réfugiés et résistants des massacres communistes. Ils circulent sous deux formes : écrits si l'auteur sait écrire, sinon sur cassette et chantés par leur auteur (par ailleurs, les landays sont traditionnellement chantés). Un signe de la condition des femmes durant cette période : aucun landay recueilli n'est signé. Comme vu plus haut, les résistants étaient plutôt de tendance rigoriste, et il n'était pas permit aux femmes de pratiquer librement la poésie.
Voici un exemple de landay :
En secret je brûle, en secret je pleure,
Je suis la femme pashtoune qui ne peut dévoiler son amour.
Ces deux livres montrent un Majrouh éprit d'art, de liberté, d'égalité. On retrouve ses penchants dans son chef d'œuvre : Ego-Monstre.
Composé de deux tomes, c'est un conte poétique et philosophique développant la pensée de Majrouh. Publié initialement en 1973, Majrouh le retouchera jusqu'à la fin de sa vie en 1988. Le premier tome, Le Voyageur de Minuit (qui donnera son nom à l'édition française intégrale) est également le plus abouti. Majrouh y raconte comment l'Ego, sous la forme de la soif de pouvoir et de la religion, détruit tout sur son passage. Je n'ai pas d'élément pour appuyer ce sentiment, mais il me semble que le second tome, Le Rire des Amants, a été rédigé après le coup d'Etat communiste : les dénonciations y sont beaucoup plus directes, la métaphore du communisme devient très transparente, et les fondamentalistes religieux (les moudjahidin) sont décrits sans aucune modification, ils ne leur manquent que d'être nommés. En étant aussi direct, le côté poétique s'en retrouve diminué, et c'est en cela que je le qualifie de moins abouti. Ces critiques qui ne sont plus voilées lui ont coûté la vie en 1988, même si les coupables finaux n'ont pas été clairement identifiés.
Néanmoins, ce conte reste hautement recommandable, la lecture en est très plaisante et invite réellement à la réflexion. De plus, au vu des cibles des critiques, ce récit n'aurait pas pu naître en France (comme les landays par ailleurs), il s'agit donc d'une réelle ouverture sur la littérature afghane.
2. La vie en Afghanistan
La plaine de Caïn de Spôjmaï Zariâb, Les figues rouges de Mazâr de Mohammad Hossein Mohammadi et Danser dans la mosquée d'Homeira Qaderi sont des œuvres racontant la vie quotidienne en Afghanistan, irradiées par les conflits armés et les répressions infligées par les religieux. Aucune histoire ne se finit bien, la mort, les mariages forcés, la violence physique, la maladie, les interdits moraux, la peur et le désespoir sont au cœur de chaque récit. Je trouve Les figues rouges de Mazâr très bon, de par la diversité des histoires et des points de vue proposés, je retiens particulièrement Les morts racontant un cycle de vendetta au cours d'un conflit armé indéterminé, et le Désert de Leyli, sur l'intervention de soldats américains en 2001.
Danser dans la mosquée est un récit autobiographique, balayant de la jeunesse jusqu'à l'exil de l'auteur. J'ai trouvé particulièrement marquant le passage où Homeira Qaderi monte une école clandestine, initialement à destination des jeunes filles, au risque de se faire surprendre par les talibans.
3. Légendes et coutumes afghanes
Pour rappel, ce livre de Ria Hackin et Ahmad Ali Kohzad est relativement ancien, puisqu'il est le fruit d'enquêtes menées au cours des années 30, et aucun des auteurs n'est sociologue ou ethnologue de profession. Par certains aspects, il a donc bien vieilli : les légendes, contes et coutumes ne sont que très peu remis dans leur contexte. C'est particulièrement flagrant pour le passage sur les coutumes : un mariage afghan est décrit, mais si cette coutume est autant vrai chez les hazâras que chez les pachtounes, de quel niveau de richesse faut-il disposer pour prétendre à une telle cérémonie, cette cérémonie est-elle propre aux sunnites, etc.
Néanmoins, il propose une autre vision de l'Afghanistan. Une grande partie du livre est consacrée à la vallée de Bâmiyân, où la vie semble relativement douce, et les habitants attachés aux statues géantes des Bouddhas, qui seront dynamitées en 2001 par les talibans. Le mariage décrit, certes forcé, est l'occasion d'une grande fête, qui est l'occasion de musiques, danses, chants, etc., autant de choses interdites aujourd'hui.
En revanche, ce livre semble présenter un intérêt historique pour la découverte de l'Afghanistan par le grand public français, puisqu'il est cité, soit directement dans le texte soit en note de bas de page, dans presque tous les autres livres de la liste.
Vers de nouveaux horizons
Avant de quitter l'Afghanistan, voici un exemple du dari et du pachto, parlées en Afghanistan. A gauche, le mot dari écrit en dari, et à droite le mot pachto écrit en pachto.




Et maintenant, direction l'Afrique du Sud !